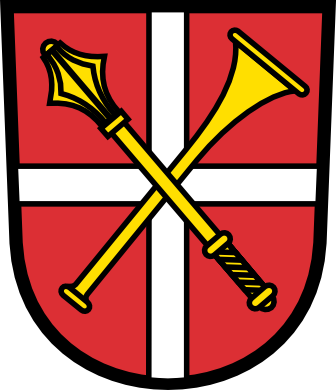Publications
Notre principale publication paraissant régulièrement:
Archives Héraldiques Suisses
Archivum Heraldicum
ISSN: 1423-0534
Open Access
Les auteurs ont immédiatement le droit de disposer librement du PDF de leur article. Toutefois, et selon la politique Green Open Access, un délai d'embargo de 12 mois est observé pour l'ensemble de l'édition. A partir de ce moment, l'édition dans son ensemble est également disponible sur e-periodica.
Annonce: Changement de rédaction 2020
Après huit ans d’activité, le rédacteur en chef, Rolf Kälin, remettra cette fonction à son successeur dans le courant de cette année. En 2008, il avait été élu membre de la commission de rédaction. De 2009 à 2012, il a ensuite été rédacteur de langue allemande avant que le comité de la SSH ne lui confie la charge de rédacteur en chef en 2012.
Lui succédera l’actuel rédacteur de langue allemande, le Dr Horst Boxler, qui assumera les tâches et la responsabilité de l’édition des Archives héraldiques suisses 2021 et dirigera l’organe de la SSH à l'avenir.
La nouvelle rédactrice de langue allemande sera Madame Sarah Keller, Dr ès lettres. En outre, après la mort de Carlo Maspoli, un nouveau rédacteur de langue italienne a pu être recruté en la personne de Niccolò Orsini de Marzo, membre du comité.
2020
Héraldique seigneuriale paysanne à St. Stephanus de Genhofen, commune de Stiefenhofen, arrondissement de Lindau, en Souabe bavaroise - Horst Boxler
À propos du sceau de Guillaume de Beaujeu, maître du Temple - Jean-Bernard de Vaivre
Un lion rampant sur champ billeté, avec diverses variantes et souvent un lambel, figure dans les sceaux des Beaujeu du Forez et d’Auvergne. Peu de maîtres des ordres militaires ont usé de sceaux à leurs armes personnelles au XIIIe siècle. On connaît toutefois celles de Guillaume de Beaujeu. Il a usé d'un contre-sceau privé au revers du grand sceau du Temple sur un document unique conservé : un acte de 1286 qui intéresse directement l'histoire de la Terre sainte. Le lion sur champ de billettes y figure bien. Or, jamais on ne trouve de lion dans les armes portées par les Beaujeu comtois, auxquels certains ont longtemps voulu rattacher Guillaume. Ces derniers portèrent sans discontinuer une croix cantonnée de billettes au nombre variable. Si le cas des armes Beaujeu a, d'une manière générale, été bien mal traité, la conclusion dûment étayée ici revient à intégrer le maître du Temple Guillaume de Beaujeu à la famille d’Auvergne.(Gaëtan Cassina)
Sceau de Jean d’Épône, prieur de l’Évière - Jean-Bernard de Vaivre
Taque de 1594 aux armoiries de Pierre Berney provenant de l’Abbaye (Vallée de Joux, VD) - Pierre-Yves Favez
La “clef héraldique” du secrétaire-tabernacle des Archives d’État de Saint-Gall - Benno Hägeli
Armorial de la Schildnerschaft de la Guilde des héraldistes zurichois - Rolf Kälin
Sin fastitgs dils castellans dil Signeradi Maiavilla 1509-1797/99 - Aluis Maissen
Armoiries en relation avec des contes et légendes – Particularités utiles à l’analyse des armoiries des cantons, des districts et des communes - Hans Rüegg
Le monde des légendes et des récits est infiniment varié. Ce n’est donc pas un miracle que certains aient trouvé un écho dans l’héraldique. Il était pour ainsi dire dans leur nature qu’ils se répandent principalement dans les contrées rurales, car le rapport à la nature et particulièrement à l’univers des montagnes jadis redouté, imprégnait de manière directe la vie des populations, paysans et bergers alpins astreints à trouver leurs moyens d’existence dans ce contexte. Les statistiques montrent que de telles armoiries proviennent respectivement au nombre de 6 du Tessin, 5 de Suisse centrale, du Valais, de l’Argovie et de l’Oberland bernois, 2 du nord-ouest de la Suisse, de Vaud et des Grisons. Actuellement, lors des créations suscitées par les fusions de communes, on ne puise plus que très rarement des motifs dans le passé ou on refuse d’éventuelles propositions de ce genre, ce qui est regrettable.(Hans Rüegg, trad. Gaëtan Cassina)
La lettre de noblesse d’Alphonse de Sandoz – Un exemple de la pratique de promotion sociale dans le Canton de Neuchâtel sous la souveraineté prussienne - Gerhard Seibold
A quoi bon un armorial (du Jura) ? Menues réflexions sur l’héraldique, le grand public et les sciences humaines - Nicolas Vernot
Sceaux, drapeaux et armoiries de la ville et république de Fribourg en Nuithonie (1157-1798) - Pierre Zwick
Cette première association, dans un seul écu, du drapeau et du sceau a donné naissance à l’interprétation erronée que la ville de Fribourg aurait eu au Moyen Âge deux sortes d’armes. L’écu écartelé orné seulement d’une couronne fleuronnée fut adopté comme armoiries de la ville et république de Fribourg. Son usage prendra fin avec la chute de l’Ancien Régime. Lorsque ville et canton furent séparés, en 1803, les armoiries firent aussi partie de la répartition des biens. Au canton le « coupé de sable et d’argent » et à la ville le « d’azur à tour crénelée d’argent, senestrée d’un avant mur crénelé du même, s’abaissant en deux degrés ».(Gaëtan Cassina)
2019
Le “manuscrit d’Aulendorf” (Die Aulendorfer Handschrift) de la chronique du Concile de Constance d’Ulrich Richental et le contexte familial de son commanditaire - Horst Boxler
Armas al fresco el Casti Salenegg - Las schlattas da niebel en Rezia - Aluis Maissen
Armoiries faisant référence à des sobriquets et des surnoms – Analyse détaillée des armoiries des cantons, des districts et des communes suisses - Hans Rüegg
De la monarchie à la république – l’évolution des armoiries communales autrichiennes - Michael Göbl
Pankraz Vorster, dernier prince-abbé de Saint-Gall, et ses dernières années passées à l’abbaye de Muri - Josef Kunz
Des armoiries en l’honneur de Paracelse à Einsiedeln, son village natal - Rolf Kälin
Officiers suisses au service des rois de France décorés de l’Ordre de Saint-Michel 1554-1665 - Michel Popoff
L’évolution de la figuration sculptée des armoiries du grand maître Pierre d’Aubusson (1476-1503) - Jean-Bernard de Vaivre
L’héraldique de la souveraineté française sur le duché de Milan (3e partie) - Gianfranco Rocculi
2018
Un trésor du Bodensee : la chronique du Concile de Constance (1414-1418) d’Ulrich Richental et sa transmission - Ludwig Biewer
Les comtes de Neipperg, bourgeois helvétiques grâce à une erreur de Johann Stumpf, et les princes de Montenuovo - Horst Boxler
Les Eguilly et les Saffres - Jean-Bernard de Vaivre
La chapelle Saint-Luc de Soroni (Rhodes) fondée par un chevalier de Saint-Jean - Jean-Bernard de Vaivre
Marguerite-Jeanne et Charlotte de Pestalozzi Chanoinesses-comtesses du Chapitre noble de Salles-en-Beaujolais - Michel Francou
La communauté suisse de l’Ordre des chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem et la frise héraldique perdue de Beromünster - Rolf Kälin
Les nouvelles armoiries du Gothard à l’usage des chemins de fer fédéraux - Rolf Kälin
Wappen und Siegel der Dynastie von Schauenstein-Ehrenfels – Herren zu Hohentrins, Tamins und Reichenau - Aluis Maissen
Armoiries en relation avec des événements et des faits historiques – Particularités utiles à l’analyse des armoiries des cantons, des districts et des communes - Hans Rüegg
Les armoiries parlantes dans l’héraldique communale médiévale – une synthèse statistique - Alessandro Savorelli
L’héraldique de la souveraineté espagnole sur le duché de Milan - Gianfranco Rocculi
2017
Les seigneurs temporels de la collégiale d'Embrach et leur établissement à Winterthur et dans le Petit-Bâle (2e partie) - Horst Boxler
Héraldique et art des stalles à Genève dans la première moitié du XVe siècle - Maître Roliquin de Dordrecht - Corinne Charles
La famille Lingua - Un parcours héraldique - Giancarlo Comino
L’épitaphe méconnue de deux abbés de Muri décédés loin de leur monastère - Rolf Kälin
Heraldik auf dem Friedhof - Protestantische Grenzfriedhöfe in Brusio und Castasegna - Aluis Maissen
Classification des raisons présidant au choix de figures héraldiques – Une analyse des armoiries des cantons, des districts et des communes suisses - Hans Rüegg
Heraldische Sehenswürdigkeiten in der Johanniterkomturei in Fribourg - Pierre Zwick
2016
Das Wappen der Barrelet von Boveresse - Louis Barrelet
Der Berliner Historiker Friedrich Rühs (1781-1820) und seine Bedeutung für die Heraldik - Ludwig Biewer
Les seigneurs temporels de la collé-giale d’Embrach et leur établissement à Winterthur et dans le Petit-Bâle - Horst Boxler
Histoires «à voir» – armoiries sur et dans des maisons zougoises - Stephen Doswald und Brigitte Moser
Das Wappen der Familie de Rumine - Pierre-Yves Favez
Vitraux du début de l’ère moderne au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel - Rolf Hasler
L’armorial de la Société suisse d’héraldique au temps de sa fondation - Rolf Kälin
Les armoiries de Fridolin - Rolf Kamm
Glaris doit son saint protecteur au monastère de Säck-ingen sur le Rhin. Fondé selon la tradition par Fridolin aux environs de l’an 500, il posséda ultérieurement des domaines en pays glaronnais. Comme il fut complètement anéanti par un incendie en 1272, les plus anciennes représentations de Fridolin proviennent évidemment de Glaris. Nous trouvons son effigie en 1277 sur le sceau d’un coadjuteur glaronnais et dès 1393 sur celui du Pays de Glaris. Fridolin y est représenté en moine avec bâton et sacoche de pèlerin. Vers 1400 il figure sur la plus ancienne bannière conservée: le saint est habillé de noir, sur un fond rouge. Probablement que la couleur rouge remonte à la bannière de justice de l’Empire qui avait peut-être été enlevée aux Glaronnais au XIIIe ou XIVe siècle. Les premières armoiries de Fridolin remontent par contre au XVe siècle et proviennent des représentations sigillaires et vexillaires.
Par la suite, la couleur du champ ne changea plus. Mais un grand flou artistique régna à propos de la représentation du personnage et plusieurs versions de Fridolin coexistèrent jusqu’au XXe siècle. Cela ne changea qu’en 1958, en raison d’une avenante pression de la chancellerie fédérale et grâce à l’engagement de l’archiviste cantonal de Glaris. Avec Ernst Keller on trouva en outre un graphiste reconnu qui se chargea de la tâche. Comme la couleur de la sacoche ne faisait pas l’unanimité, on finit par supprimer cet attribut. Depuis 1960, Glaris possède des armoiries officielles de haute qualité graphique.(R. Kamm, trad. P. Zwick)
Porcelaines de Chine et jetons de nacre aux armes de familles suisses, 1740-1780 - Vincent Lieber
Heraldica Lumneziana - Wappenfresken in der Kapelle St. Sebastian und St. Rochus in Vella - Aluis Maissen
Sous l’égide de la représentation et de la légitimité – La frise des armoiries des baillis confédérés dans le château de Frauenfeld - Peter Niederhäuser
Des circonstances particulières inclinent à con-si-dérer cette «rénovation» comme un nouvel anénagement homogène, convenant à l’image identitaire de la souveraineté confédérée et de ses baillis. Cette frise héraldique peut en fait aussi être interprétée comme une réponse à des conditions politiques spécifiques. Après avoir occupé la Thurgovie en automne 1460, puis évincé pas à pas la ville de Constance, les cantons confédérés acquirent le château de Frauenfeld en 1534 pour en faire le siège représentatif de leur bailliage. Dans une Thurgovie divisée sur le plan confessionnel, la souveraineté confédérée resta cependant plutôt lâche, marquée par des déficits structurels, et elle se limita dans une large mesure aux compétences régaliennes, avant tout à la haute juridiction. La volonté d’une représentation héraldique du pouvoir devait viser à mettre l’accent sur l’ancienneté et sur l’importance politique du bailliage, ainsi qu’à légitimer de façon apparente la souveraineté des Confédérés.(P. Niederhäuser, trad. G. Cassina)
À propos de l’héraldique sous la souveraineté française dans le duché de Milan - Gianfranco Rocculi
Armoiries de communes issues de fusion – Cas problématiques ou nouvelle catégorie d’armoiries? - Hans Rüegg
Quoique homologuées en 1932 seulement, les armoiries du canton des Grisons représentent la plus notoire des combinaisons d’armoiries. Quant aux communes, les premières fusions assorties de combinaisons d’armes remontent à 1961. Ces combinaisons souffrent cependant d’une déperdition de la force expressive et de l’impression visuelle des armes d’origine. L’étude par l’auteur des armoiries des villages du canton de Zurich a révélé que de nombreux villages ou hameaux, parties de communes, possèdent leurs propres armes et drapeaux. Les blasons des communes fusionnées perdent certes leur statut officiel, mais ils peuvent toujours servir d’armoiries villageoises ou locales. Les armes dont les figures sont chargées d’une fonction numérique constituent une autre sous-catégorie de blasons résultant de fusions. Les armoiries du canton du Valais en sont l’exemple le plus fameux. Mais les fonctions numériques sont trop souvent assignées aux étoiles et il en résulte un effet répétitif ennuyeux. D’autres motifs apparaissent plus fréquemment. Rares demeurent les créations véritablement novatrices, avec de nouvelles figures remplissant les conditions d’un bon blason.(H. Rüegg, trad. G. Cassina)